Faut-il renommer le concept de «l'économie informelle» pour lui donner une connotation plus positive?
Discussion details

Question d'un membre: "nous avons besoin d'une «justification significative sur la question de savoir pourquoi un important secteur qui emploie des millions de personnes à travers le monde devrait être classé comme économie informelle. Je trouve le terme humiliant que le simple fait que la plupart des travailleurs dans le secteur ne sont pas enregistrés ne devrait pas être pour autant une raison de le classer comme informel. De ce point de vue, la question serait de trouver une description positive pour le secteur ".
Les termes d’«économie informelle» et d’«emploi informel» ne recèlent pas intrinsèquement la connotation négative que certains leur donnent aujourd'hui. Celle-ci prend ses racines dans la confusion avec l’économie de l’«ombre», l'économie «souterraine» et «illégale». De fait, certains économistes continuent d'utiliser les termes d’ »économie informelle », « économie de l’ombre", ou d’ « économie souterraine » comme si elles étaient interchangeables, alors qu’elles ne le sont pas.
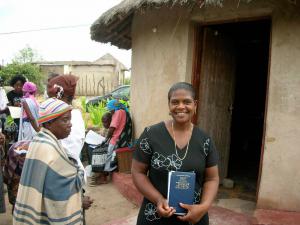
Depuis l’adoption d'une définition internationale du «secteur informel» en 1993 (et de l'emploi informel en 2003), le concept d'informalité appliqué au concept d’emploi a ainsi perdu une bonne part de son image négative. Ces définitions établissent clairement une séparation nette entre l'économie informelle et l’économie illégale et criminelle. L'usage commun du terme «économie informelle» toujours associé avec celui d’ « économie de l'ombre» est un malentendu. Peut-être des projets visant la formalisation de l'économie informelle pourront-ils œuvrer à éliminer cette confusion.
Notons que de nombreux pays ont mené des enquêtes sur le secteur informel, ce qui démontre qu'ils comprennent à quel point ces activités représentent une partie importante de leurs économies. Cette meilleure appréhension peut conduire dans l’avenir à une approche plus compréhensive pour la caractérisation des économies informelles.
Depuis son origine dans les années 1970, le terme de «secteur informel» a été une source de dispute. Une école de pensée préféra utiliser le concept de «petite production marchande». D'autres ont suggéré les termes d’«économie populaire». D'autres encore celui d'« économie spontanée » et même d' « économie populaire spontanée ».

Ainsi, bien que l'économie informelle ne soit pas nécessairement une économie illégale, il est vrai que les lois ne s’appliquent généralement pas en son sein. Toutefois, on pourrait considérer que la faute n’en revient pas à l'économie informelle, mais bien à un défaut, une inadaptation de la loi elle-même. Les lois n’ont généralement pas été conçues en ayant à l'esprit les réalités de cette économie, et il n’est donc tout simplement pas possible pour elle de fonctionner en accord avec elles. Une grande partie des efforts réalisés en vue de la promotion d'un environnement favorable pour l'économie informelle porte sur cette question. L'économie informelle peut être formalisée ce qui contribuera également à améliorer l'accès à un travail décent. En outre, alors que les conditions de travail décent sont rares dans l'économie informelle, celle-ci comporte néanmoins des avantages intrinsèques. Elle génère des revenus, est source de formation informelle et peut donner naissance à des micro-entreprises prospères. En résumé, la connotation négative de l'économie informelle et sa confusion avec une économie illégale est tout simplement un malentendu: selon les normes internationales, l'économie informelle est tout simplement non formelle, et rien de plus. Et au lieu de condamner ceux qui dépendent de l'économie informelle comme des criminels, les pouvoirs publics et les projets doivent œuvrer à la création d'un environnement formel et d’un système juridique favorables à l’exercice de ces activités.
Ainsi pour répondre à la question posée, il n’est pas nécessaire de changer le concept d'économie informelle pour un autre qui serait plus positif, car il l’est déjà.
(6)
Log in with your EU Login account to post or comment on the platform.
MA CONTRIBUTION
Merci Jacques pour cette brief.
Pour ma part,
Il reste certain que toute analyse pose la question centrale suivante: faut-il avoir une interpretation ou une connotation uniquement fondée sur le concept ou l'adjectif "informelle" ou sur la valeur sociale ou économique de cette économie dite "informelle"?
Le concept d'économie informelle tire sa qualification dans un contexte historique économique promu par les états en opposition aux initiatives visant à asseoir et promouvoir des sytèmes fondés sur des lois qui régiraient le fonctionnement d'un autre type d'entreprise dans l'administration nationale ou le secteur privé.
C'est vrai, tant de qualificatifs péjoratifs, à interprétation négative ont été utilisés pour confiner cette économie dans son "informalité", souvent même par les décideurs nationaux (pouvoirs public...).
Parodoxe de pardaoxe! En Côte d'Ivoire, comme dans plusiers pays africains et ailleurs, les états créent des Structures-Chambres Consulaires par décret officiel comme interface entre les "opérateurs économiques informels" et lui même l'Etat...Chambre de métiers, Chambre de commerce,etc. Ce qui témoigne d'une reonnaissance officielle insidieuse, décretée, acceptée, validée de "l'économie informelle".
La valeur économique et sociale de EI: Cependant, l'objectivité opérationnelle sur le terrain, nous ramène à mitiger cette conotation informelle avec une analyse qui tienne compte de la dynamique sociale et économique de ces entreprise informelles. Cela doit se saisir dans leur capacité à suciter la richesse au seins des populations; ce qui induit substantiellement sur la qualité de vie des membres des ménages (scolarisation des enfants, paiement des frais de santé, sécurité alimentaire au sein des ménages, etc...). Au dela de ces indicateurs coventionnels de bien être, l'une des valeurs ajoutés des impacts des économies dites informelles, c'est leur rôle en tant que vecteur de renforcement du capital social et d'inclusion communataire de leurs membres. Dans mes travaux de recherche (Lassiné BAMBA, 2014), indifférement de la taille de leurs entreprises "informelles", ces opérateurs accroissent leur capacité à participer aux initiatrives de leur communautés, voisinage, famille élargie, villages, etc...à travers des actifs en nature lors de funérailles, baptèmes, marriage. Ils rentrent ainsi dans un système d'échange local de dons et contre-don (MARCEL MAUSS), qui les valorise socialement, et leur donne une sorte d"utilité sociale). La socigénèse de la pauvreté nous renseigne que la pauvreté n'est pas que forcément matérielles dans nos communautés ivoiriennes issues des miluex populatire..elle se mesure plus par le dégré de participation sociale, et de reconnaissance que les membres de la communauté confèrent à une personnes...
En somme, une hypothèse de changement du concept d'économie informelle, pour une perception positive conforterait le dualisme entre les notions "formel et informel" qui participe plus à une logique de développement macro. Cependant, cela reste inopérationnel et peu objectif en tenant compte du pouvoir économique et social de ces types d' économies. Il reste donc pertinent de considérer les représentations sociales et les perceptions de ces opérateurs qui participent aux activités économiques sous l'étiquette "informel".
Quelles sont les perceptions des opérateurs économiques face au concept d'économie "informel" dans laquelle les pouvoirs publics tentent de les y maintenir?A quel dégré, et dans quelles mesures, cette perception influence t-elle leur niveau d'inclusion sociale?
Dr Lassiné BAMBA, ScD
Absolument oui Mei.
Merci
"Dans mes travaux de recherche (Lassiné BAMBA, 2014), indifféremment de la taille de leurs entreprises "informelles", ces opérateurs accroissent leur capacité à participer aux initiatives de leur communautés, voisinage, famille élargie, villages, etc...à travers des actifs en nature lors de funérailles, baptêmes, mariage. Ils rentrent ainsi dans un système d'échange local de dons et contre-don (MARCEL MAUSS), qui les valorise socialement, et leur donne une sorte d'"utilité sociale." Cet argument me semble très intéressant! Il représente une réalité quotidienne au niveau de chaque communauté. A ce niveau, il semble "plus naturel" de participer à cette vie communautaire (ou tribal, ou clanique). C'est un niveau à dimension humaine et donc on s'y reconnait, s'y identifie.
Il démontre le décalage entre cette réalité plus concrète et une réalité plus "immatérielle" que représente l'état et tous ses niveaux de pouvoir. Que représente l'état lorsque l'on vit au jour le jour dans son quotidien familial et communautaire? Est-ce que l'on s'identifie à ce niveau? Avec comme conséquence que l'on aurait envie d'y participer ou pas? Est-ce que l'informalité est-elle liée à cette identification ou plutôt à son manque d'identification? Est-ce que l'informalité se définirait par la participation au fonctionnement de cet état? Que ce soit par manque de moyens ou par volonté est un autre débat. Est-ce que "participer au fonctionnement de l'état" à la même dimension que "participer au fonctionnement de l'économie"?
Pour poursuivre le débat, on peut remarquer 3 types d’attitudes de la part des pouvoirs publics :
1) Il y a des pays comme la Côte d’Ivoire ou d’autres pays de la région qui ont créé des structures (agences, directions de ministères, voire ministères) dévolues à l’appui du secteur informel, en vue de sa formalisation à terme.
2) Il y en a d’autres qui ont toujours refusé d’adopter la terminologie d’informel parce que ce terme représente l’image même de leur impuissance à faire respecter les propres règles qu’ils édictent. Le Kenya où est né le concept (traduit en Swahili par ‘Jua Kali’ : ‘sous le soleil brûlant’) ne l’utilise plus vraiment et la Tunisie a préféré le qualifier par l’appellation d’artisanat et petits métiers.
3) Il y en a enfin qui utilisent le terme de façon entièrement négative, comme l’Algérie où il est assimilé à la contrebande et à l’économie souterraine et illégale. Ils n’y voient qu’une source de difficulté et de concurrence déloyale pour les entreprises formelles qui poussent dans ce sens d’interprétation.
L’informel dont nous parlons peut certes se greffer à l‘occasion sur le souterrain et l’illégal, mais il est fondamentalement une pure économie spontanée, celle que mettent en place les populations pauvres et démunies ou tout simplement modestes et qui ne disposent pas d’appuis de la part de l’Etat pour survivre ou tout simplement vivre dans un monde de plus en plus complexe et qui semble ne se manifester que par les barrières de plus en plus nombreuses et les initiatives inadaptées à la réalité que ces populations vivent et qu’il s’ingénie à mettre en place.
Bien que cela soit de plus en plus rare, dans certains pays où continuent à exister des sociétés traditionnelles, nomades par exemple, les concepts de chômage et d’emploi n’ont aucun sens. Personne n’est chômeur, tout le monde a un rôle à jouer et des tâches qui lui sont assignées par la société : c’est un monde totalement formel pour lui-même et totalement informel pour l’Etat. L’informel n’apparaît que parce qu’une société (que l’on peut qualifier de moderne pour faire vite) est venue se greffer sur ces anciennes sociétés, qui n’ont que le choix de se soumette et de payer l’impôt dont elles ne voyaient aucune contrepartie.
Le monde de l’informel que nous observons aujourd’hui a ses règles, ses solidarités, ses sources de conflits : dons et contre-dons y existent, mais de plus en plus pervertis par la recherche du gain et l’intérêt. Parmi ses membres, certains peuvent se satisfaire d’un système qui cherche à se reproduire plus ou moins à l’identique. Pour ceux-là l’Etat peut et devrait veiller à ce que la pression qu’il exerce n’en vienne pas à perturber les fragiles équilibres sur lesquels reposent leurs modes de vie, des activités simplement destinées à générer des revenus pour satisfaire leurs besoins de base. D’autres peuvent se laisser gagner par la nouvelle philosophie du développement, de l’accumulation et de l’enrichissement. C’est à eux que s’adressent les politiques volontaristes de l’Etat développeur. Il y a aussi une troisième catégorie qui s’observe en Afrique du Nord où le choix de l’informel est volontaire par déni de l’Etat et radicalisme politique et religieux : ne rien donner à l’Etat et ne rien lui devoir. Opérer dans l’informel est devenu un dogme qui cherche sciemment à contrevenir aux règles et aux normes étatiques en prospérant sur les activités de contrebande.
[Translation of post by Bamba Lassine dated 24/09/2015]
Jacques thank you for this brief.
For my part, it is certain that any analysis poses the central question: should we have interpret this based solely on the concept of the "informal" adjective or instead on the actual social or economic value of the economy that is referred to as "informal"? The concept of the informal economy draws its meaning from an economic historical context promoted by the states. It is in opposition to efforts to anchor and promote law based systems that govern the operation of companies in public administration or the private sector.
It is true, so many derogatory epithets, negative interpretations were used to confine this type of economy in its "informality", often by national decision makers (public authorities...).
Paradox of paradoxes! In the Côte d'Ivoire, as in several African countries and elsewhere, the states create structures by official decree to act as an interface between the "informal traders" and itself that is the “State” ... Chambers of Trade, Chamber of Commerce etc. This testifies to an insidious official recognition that has decreed, accepted and validated of "the informal economy".
The economic and social value of Informal Economy: However, the operational objectives in the field, bring us to mitigate this informal connotation with an analysis that takes into account the social and economic dynamics of these informal enterprises. We must consider their ability to create wealth in the population; which substantially strengthens the quality of life of households (school attendance, payment of medical expenses, food security within households, etc....). Beyond these usual indicators of well-being, one of the added values of informal economy activities is their role in building social capital and a sense of community inclusion of their members.
In my research (Lassiné Bamba, 2014), independent of the size of their "informal" businesses, these operators increase their ability to participate in their communities initiatives, neighbourhood, extended family, villages, etc. ... through sharing assets in kind at funerals, baptisms, marriage. They thus fall within a local system of exchange of gifts and counter-gifts (Marcel Mauss), which promotes socially, and gives them a kind of "social utility”.
Poverty is not necessarily only material in our Ivorian communities. It is measured by the degree of social participation and recognition that community members given to a person….
In short, the assumption of changing the informal economy concept for a positive perception would reinforce the dualism between "formal and informal" concepts, which is more macro development logic. However, it is not very objective if we take into account the economic and social potential of these types of economies. It thus remains relevant to consider the social representations and perceptions of those operators who participate in economic activities under the label "informal".
What are the perceptions of traders’ face-saving concept "informal" in which governments are trying to keep them there? To what degree, and to what extent, this perception does it influence their level of social inclusion?
Great!
Thanks Mei