Cet article est également disponible en anglais.
Bien que les origines de la COVID-19 soient encore inconnues, la plupart des explications pointent vers une source animale. La transmission de maladies de l'animal à l'homme n'est pas rare, mais cette pandémie a intensifié le débat sur la consommation généralisée de viande d'animaux sauvages. L'UE cofinance une initiative internationale majeure visant à améliorer la préservation de la faune et la sécurité alimentaire.
La chasse aux animaux sauvages pour se nourrir (viande sauvage) est mise en avant depuis le début de la pandémie de la COVID-19. Le risque potentiel pour la santé publique de la consommation de ce type de protéines animales a divisé la communauté internationale entre ceux qui voudraient interdire cette pratique et ceux qui voudraient mieux la réglementer.
C'est un débat complexe ; des millions de personnes dépendent de la viande sauvage pour leur alimentation et leurs revenus, en particulier dans les régions tropicales et subtropicales. Une gestion durable de la chasse aux animaux sauvages est nécessaire pour améliorer la préservation de la faune et la sécurité alimentaire. À cette fin, l'UE, conjointement avec l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) et le Fonds français pour l'environnement mondial (FFEM), a lancé en 2018 le Programme de gestion durable de la faune sauvage (SWM) dans 13 pays1.
Meilleures pratiques du SWM Programme :
Sandra Ratiarison, coordonnatrice du SWM Programme pour l'Afrique Centrale et Madagascar (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, FAO), partage certaines des approches innovantes utilisées par le programme :
- Programmation flexible respectant les droits des communautés: les besoins, les droits et les intérêts des populations autochtones et des communautés locales sous-tendent toutes les activités du SWM Programme afin de garantir que le travail soit culturellement sensible et durable. Les communautés sur les sites du SWM Programme sont impliquées dans la définition des objectifs du projet et des activités qui les impliquent ou peuvent avoir un impact sur elles. Elles sont consultées sur la mise en œuvre pratique du projet et conviennent de la manière d'être tenu informées grâce à un processus de consentement libre, préalable et informé2 .
- Gestion adaptative en intégrant les meilleures pratiques: le SWM Programme utilise un système complet de suivi, d'évaluation et d'apprentissage, basé sur la théorie du changement pour les huit modèles de gestion durable de la chasse aux animaux sauvages testés sur les sites du projet, pour évaluer et adapter les activités. Cette approche systématique permet à l'équipe de tester des hypothèses, d'apprendre et de générer des leçons ainsi que d'appliquer les meilleures pratiques.
- Effort collaboratif: le SWM Programme rassemble des partenaires ayant des points de vue, des domaines d'expertise et des modes de fonctionnement différents. Sa structure de gouvernance encourage le débat et l'innovation. Cet environnement encourage les approches intersectorielles et interdisciplinaires telles que l'approche « un monde, une santé » pour s'attaquer aux causes profondes des maladies zoonotiques.
Des solutions adaptées aux besoins des populations : Congo et Gabon

L'approche ascendante adoptée par le SWM Programme garantit une participation significative des communautés locales sur les sites du projet. Germain Mavah, le coordonnateur du SWM Programme en République du Congo (Wildlife Conservation Society) explique: « tout en recherchant des solutions pour la conservation de la faune sauvage et la sécurité alimentaire, nous devons travailler avec les communautés. Ce serait une perte de temps et de ressources de promouvoir la pisciculture dans un village où l’écosystème et la tradition soutiennent l’élevage de moutons. »
Au Gabon, ce dialogue avec les communautés locales a conduit à d'importants ajustements dans l'orientation du SWM Programme. Sandra Ratiarison explique : « nous avons initialement proposé de réduire la dépendance de la communauté à la viande sauvage en encourageant la production locale et le commerce de protéines animales alternatives telles que la volaille ou le poisson. Nous avons écouté attentivement la communauté et découvert que la plupart des villages avaient déjà accès à de la viande importée, mais qu'ils devaient continuer à bénéficier des revenus générés par la viande d'animaux sauvages pour subvenir à leurs besoins de base. »

Germain Mavah explique que la durabilité des ressources fauniques pour l'alimentation dans les zones rurales implique de joindre ces communautés avec celles des zones urbaines dans la gestion de la faune. « L'une des principales solutions est de réduire la consommation de viande d'animaux sauvages dans les villes régionales. L'application de la loi à elle seule s'est révélée inefficace. Dans le SWM Programme, nous pensons que changer les modes de consommation de viande sauvage en augmentant la disponibilité de viande et de poisson produits de manière durable, en réduisant la disponibilité de viande sauvage et en encourageant un changement de comportement alimentaire peut faire une différence. En outre, développer de nouvelles opportunités de subsistance dans les zones périurbaines et rurales en développant l’élevage et le commerce d’animaux domestiques peut être rentable pour les populations rurales et urbaines. »
Partage d'expériences et de connaissances

Le partage d'informations et d'approches innovantes est l'une des principales caractéristiques du SWM Programme. Les équipes de terrain du SWM Programme génèrent des connaissances inestimables dans de nombreuses disciplines différentes. Les sujets vont de la chasse à la faune sauvage pour l'alimentation et des chaînes de valorisation de la viande sauvage à la consommation. Ils couvrent également différentes lois (statutaires, coutumières) qui régissent la gestion des ressources naturelles jusqu'aux changements nécessaires dans un large éventail d'aspects pour atteindre le double objectif de préservation de la faune et de sécurité alimentaire. Ces informations seront utilisées pour développer et intensifier les bonnes pratiques.
En octobre 2020, en réponse au débat public provoqué par la pandémie, le SWM Programme a publié le Livre blanc: Reconstruire mieux dans un monde post-Covid-19 - Réduire les risques de propagations de maladies à l’homme liés à la faune sauvage.
Robert Nasi, directeur général du Centre pour la recherche forestière internationale (CIFOR), explique l'idée derrière la publication de ce livre blanc et de la note d'orientation politique associée : « le but était, entre autres, d'équilibrer le débat. Il n'est pas utile d'interdire la chasse et de fermer les marchés publics vendant des denrées périssables sans proposer d'alternatives. Le problème, ce ne sont pas les marchés, mais plutôt la chaîne d'approvisionnement. »
Le SWM Programme préconise des mesures préventives pour réduire les risques de futures épidémies, créer des environnements plus sains et plus sûrs et rétablir l'équilibre entre les humains et la nature. Pour reprendre les termes de Robert Nasi, « les propositions incluses dans cette note d'orientation relèvent du bon sens ».
Équilibre homme-nature en Zambie et au Zimbabwe
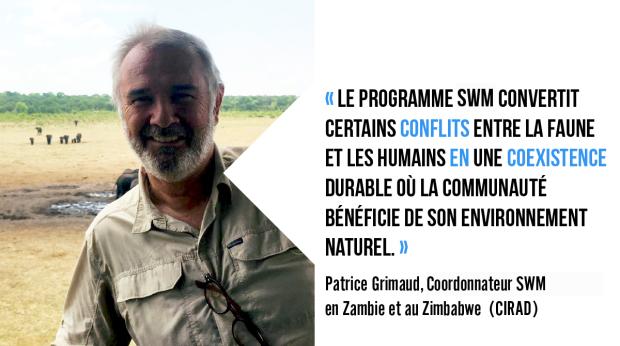
L'Afrique australe est différente. Patrice Grimaud du Centre international de recherche agronomique pour le développement (CIRAD), coordonnateur du SWM Programme en Zambie et au Zimbabwe, explique : « Le problème en Afrique centrale est la consommation humaine de viande sauvage. La préoccupation dans les pays d'Afrique australe est de savoir comment permettre une coexistence durable entre la faune et les communautés locales. »
Dans des pays comme la Zambie et le Zimbabwe, les pratiques de chasse sont très réglementées. La population locale a tendance à consommer des protéines animales provenant de volailles ou de chèvres domestiques plutôt que de viande sauvage. Les espèces sauvages sont considérées comme importantes pour des raisons économiques (tourisme principalement) mais elles sont souvent en conflit avec les communautés locales qui partagent leurs habitats. La perturbation des marchés causée par la pandémie de COVID-19 a également conduit à une augmentation du braconnage.
Des conflits surviennent lorsque des hyènes ou d'autres carnivores attaquent des villages et lorsque des éléphants piétinent les cultures agricoles. Le SWM Programme travaille avec les administrations locales en charge des aires protégées et des parcs nationaux, les entreprises privées exploitant des réserves de chasse et la population locale pour trouver des solutions appropriées.
Patrice Grimaud explique : « Dans un premier temps, nous avons mené plusieurs enquêtes de terrain pour comprendre l'environnement et les enjeux. Nous avons également organisé des séances d'information avec les habitants et les parties prenantes pour comprendre leurs problèmes et leurs besoins. » Le programme a ensuite aidé la population locale à trouver des solutions immédiates pour limiter les conflits tout en améliorant les moyens de subsistance. Cela comprend l'installation de bomas mobiles, des structures en toile de plastique opaque, pour protéger le bétail des attaques des carnivores tout en augmentant la fertilité du sol, et l'installation de ruches à côté des cultures pour à la fois effrayer les éléphants et permettre aux villageois d'obtenir et de commercialiser du miel. Une meilleure gestion de l'eau pour éviter les conflits autour des points d'eau est également encouragée. Des solutions durables à plus long terme sont également explorées à travers la création de conservatoires communautaires3.
La nécessité de trouver un équilibre durable entre la sécurité alimentaire et la conservation des espèces sauvages est claire. La crise actuelle de la COVID-19 a souligné l'importance de la préservation des écosystèmes naturels et de la réduction de la demande de viande sauvage là où ce n'est pas une nécessité nutritionnelle ou culturelle, afin de réduire le risque de propagation de maladies zoonotiques. Le SWM Programme soutenu par l'Union européenne joue un rôle important dans la résolution de ces problèmes complexes et le développement de solutions qui peuvent être adaptées et reproduites dans de nombreux autres pays et régions.
Cliquez sur le bouton de lecture ci-dessous pour regarder notre vidéo sur le SWM Programme.
Autres épisodes de la série climat et environnement (en anglais):
- Episode #1: Larger than Jaguars: Biodiversity protection in the LAC region
- Episode #2:Improving wildlife conservation and food security with local communities
- Episode #3: Local heroes protecting the world's biodiversity hotspots
- Episode #4: Team Europe-Kenya Partnership: community-led wildlife conservation
Crédit: Video © Capacity4dev | Photo © Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)/Thomas Nicolon , 2019
[1]Le SWM Programme est mis en œuvre par l' Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) , la Wildlife Conservation Society , le Centre international de recherche agronomique pour le développement (CIRAD) et le Centre pour la recherche forestière internationale (CIFOR) au Tchad, en République Démocratique du Congo, en Égypte, au Gabon, au Guyana, à Madagascar, au Mali, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Sénégal, au Soudan, en République du Congo, en Zambie et au Zimbabwe.
[2]Le consentement libre, préalable et informé (CLIP) est un droit spécifique qui appartient aux peuples autochtones et qui est reconnu dans une série d'instruments juridiques internationaux. Le droit au CLIP fait partie du droit collectif des peuples à l'autodétermination, qui leur permet non seulement d'accorder ou de retirer leur consentement pour un projet à n'importe quel stade, mais comprend également le droit de déterminer quel type de processus de participation, de consultation et la prise de décision leur convient. Le SWM Programme étend ce droit aux peuples autochtones et aux communautés locales dans toutes ses activités de projet. Pour plus d'informations sur l'approche du SWM programme, regardez cette courte animation « Droits communautaires et conservation de la faune sauvage ».
[3]Les conservatoires communautaires sont des zones légalement reconnues, définies géographiquement, qui ont été formées par des communautés qui se sont unies pour gérer et profiter de la faune et d'autres ressources naturelles.






Comments (1)
Log in with your EU Login account to post or comment on the platform.
Oui, la problématique des rapports, interface ''Humains-Nature (faune)'' est plus que jamais d'actualité, surtout en cette période de crise sanitaire avec la Covid-19. Nous devons de l'aborder avec sérieux et efficacité pour faire de sorte que le monde de demain (d'aprés Covid) soit diamétralement opposé au monde d'avant. Sin nous ne faisons rien de durable et de pratique, la situation risque d'empirer et nous (planéte Terre et humanité) irons tout droit vers la catastrophe. Soit ça passe, ou ça casse. Merci
Dr. FAYE SENY (post-PHD researcher and Manager, international consultant)